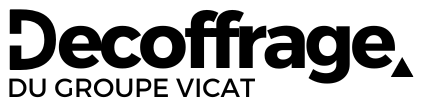- Guides > Cure béton
La cure du béton : une étape essentielle à ne pas négliger
Le 8 juillet 2025 - ⏱️️ 8 min
Votre projet en béton
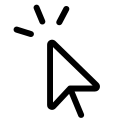
La cure du béton est une étape cruciale du processus de construction. Trop souvent négligée, elle conditionne pourtant directement la qualité, la durabilité et les performances mécaniques du béton. En effet, le béton fraîchement coulé doit conserver suffisamment d'humidité pour que l’hydratation du ciment se poursuive de manière optimale. Sans cette hydratation, les propriétés mécaniques et la pérennité de l’ouvrage sont compromises.
Ce guide vise à fournir une vue d’ensemble complète sur la cure du béton, ses objectifs, ses méthodes, sa durée, les normes en vigueur, ainsi que les risques liés à une cure inadéquate.
1. Qu’est-ce que la cure du béton ?
La cure désigne l’ensemble des actions mises en œuvre après le coulage du béton pour protéger ce dernier contre la perte prématurée d’humidité, les chocs thermiques et les conditions climatiques défavorables. Elle permet au béton de mûrir dans de bonnes conditions, garantissant ainsi un durcissement homogène et progressif.
Le but principal est de préserver l’eau nécessaire à l’hydratation du ciment, afin de permettre le développement des résistances mécaniques et la formation d’une microstructure dense, peu poreuse, durable.
2. Pourquoi la cure est-elle indispensable ?
3.1 Assurer l’hydratation du ciment
Le ciment réagit chimiquement avec l’eau par un processus appelé hydratation. Cette réaction est lente et se poursuit plusieurs jours après la mise en œuvre. Si l’eau vient à s’évaporer trop tôt, l’hydratation est incomplète, laissant un béton faible et poreux.
3.2 Favoriser le développement des résistances mécaniques
Une cure correcte permet une montée progressive en résistance. Elle est notamment déterminante pendant les 7 premiers jours, période critique pour la prise du béton.
3.3 Limiter les pathologies en surface
Sans cure, les premières couches du béton peuvent se dessécher, créant :
des fissures superficielles dues au retrait plastique,
une mauvaise adhérence des revêtements,
un poudroiement ou farinage de surface,
une porosité accrue dans la zone d’enrobage des armatures.
3. Les conditions climatiques à surveiller
La vitesse de dessiccation dépend de plusieurs facteurs :
🌡 Température de l’air : plus elle est élevée, plus l’eau s’évapore vite,
💨 Vitesse du vent : le vent augmente le taux d’évaporation,
☀️ Ensoleillement : accentue le réchauffement du béton,
💧 Humidité relative de l’air : un air sec aspire davantage l’humidité du béton.
Il est conseillé de renforcer la cure lorsque :
T° > 25 °C,
Humidité < 60 %,
Vent > 40 km/h,
T° de surface du béton < 5 °C (la cure est alors suspendue).
4. Méthodes de cure
Il existe deux grandes familles de techniques de cure :
5.1 Méthodes visant à limiter l’évaporation
Ces techniques consistent à conserver l’humidité présente dans le béton :
Maintien du coffrage : empêche l’air d’atteindre la surface,
Films plastiques étanches (polyane) : appliqués dès la mise en œuvre,
Bâches thermiques ou géotextiles humidifiés : protègent et maintiennent l’humidité,
Application de produits de cure : formant un film imperméable à la surface.
5.2 Méthodes par apport d’eau
Elles visent à compenser l’eau perdue par évaporation :
Arrosage régulier de la surface,
Pulvérisation de brouillard d’eau,
Immersion ou nappage (pour petites pièces),
Couvertures humides maintenues détrempées.
Le choix de la méthode dépend :
Du type d’ouvrage (dalle, voile, fondation…),
De la surface exposée,
Du planning chantier,
Des conditions météo.
5. Les produits de cure : définition et utilisation
Un produit de cure est un agent liquide appliqué sur le béton frais pour former une pellicule protectrice empêchant l’évaporation de l’eau.
6.1 Composition
Les produits de cure se composent généralement de :
Un véhicule : solvant organique ou eau (émulsion),
Un liant : résine, polymère,
Parfois des charges minérales : dioxyde de titane, pigments pour repérage visuel.
6.2 Application
Ils sont pulvérisés à un dosage de 100 à 300 g/m², via :
Pulvérisateur manuel,
Rampe de pulvérisation motorisée.
Norme applicable : NF P 18-370. Il est recommandé d’utiliser des produits certifiés marque NF – produits de cure.
6. Quand curer le béton ?
La cure doit commencer immédiatement après la mise en œuvre, sans attendre :
Pour les surfaces horizontales : juste après surfaçage ou hélicoptérage,
Pour les éléments verticaux : dès le décoffrage,
Pour les bétons désactivés : après lavage.
Elle doit être poursuivie jusqu’à l’obtention d’une résistance suffisante à la compression.
Si la température à la surface du béton est < 5 °C, le temps de cure est interrompu jusqu’au retour à une température supérieure.
7. Durée minimale de cure
La durée dépend :
De la formulation du béton,
De la vitesse de prise (rapport R₂j / R₂₈j),
De la température à la surface du béton,
Des conditions climatiques ambiantes.
Quelques repères :
| Température moyenne | Rapport R2j/R28j ≥ 0,5 | Durée minimale (jours) |
| 20 °C | Oui | 3 jours |
| 10 °C | Non | 7 jours |
| < 5 °C | Non | Cure suspendue |
Ces valeurs sont issues de la norme NF EN 13670 et du Fascicule 65 (ouvrages à 100 ans de durée de vie).
8. Les classes de cure
La norme NF EN 13670 introduit la notion de classe de cure, à intégrer dans les CCTP.
| Classe de cure | Exigence | Exemple d'application |
| Classe 1 | Faible | Bétons temporaires |
| Classe 2 | Courante | Bétons usuels |
| Classe 3 | Renforcée | Bétons en milieu agressif |
| Classe 4 | Très exigeante | Ouvrages d’art, génie civil |
Le choix de la classe est du ressort du maître d’ouvrage, et dépend des performances attendues en surface.
9. Pathologies en cas de cure insuffisante
L’absence de cure ou une cure trop courte entraîne :
Défauts visibles :
Fissuration superficielle,
Poudroiement ou farinage de surface,
Mauvaise adhérence des peintures ou revêtements.
Défauts invisibles mais graves :
Porosité accrue en surface,
Altération de la zone d’enrobage des armatures,
Vulnérabilité accrue aux agents chimiques (CO₂, chlorures),
Moins bonne durabilité de l’ouvrage.
Conclusion
✅ La cure est obligatoire pour tous les bétons,
⏱ Elle doit commencer immédiatement après mise en œuvre,
🧊 Elle doit être renforcée par temps chaud, sec ou venteux,
📏 Sa durée est fonction de la température et de la prise du béton,
🔧 Plusieurs méthodes sont possibles, selon les besoins du chantier.
La cure du béton est une étape essentielle et non optionnelle pour garantir la qualité, la performance et la durabilité d’un ouvrage. Elle doit être mise en œuvre immédiatement après le coulage et adaptée aux conditions climatiques du chantier. Son objectif principal est de préserver l’humidité nécessaire à l’hydratation du ciment, condition sine qua non pour que le béton atteigne ses résistances mécaniques optimales et reste durable dans le temps. Une cure bien réalisée limite les fissures, renforce la compacité du béton, améliore l’enrobage des armatures, et prévient les pathologies de surface. À l’inverse, une cure négligée ou interrompue peut fortement compromettre la tenue de l’ouvrage. Enfin, il est fondamental de choisir une méthode de cure adaptée (film plastique, arrosage, produit de cure…) et de respecter la durée minimale recommandée, surtout en période de forte chaleur ou de vent. Ne pas curer, c’est prendre le risque de tout perdre, même avec un béton bien dosé.