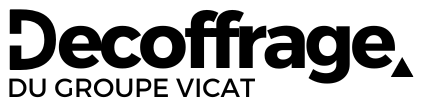DÉCOFFRAGE N°3 - Face aux défis climatiques
Face aux défis climatiques : comment rendre nos constructions plus résilientes ?
- Décoffrage : Newsletter
- Face aux défis climatiques
Face à l'intensification des risques environnementaux liés au changement climatique, le secteur de la construction fait face à de nouveaux défis.
Inondations, sécheresses, canicules ou encore tempêtes impactent directement les bâtiments, infrastructures et populations. Un constat qui pousse à la réflexion : comment repenser les pratiques de conception et de construction pour s’y adapter ? Anticiper et agir face à l’impact du changement climatique est clé pour préserver la durée de vie des ouvrages et le confort d’usage des habitants.
Voici quelques éléments de réponse.
Des phénomènes climatiques de plus en plus extrêmes
Le réchauffement climatique s’intensifie de manière significative : la France métropolitaine a connu une hausse de sa température annuelle moyenne de 2,6°C entre les années 1961-1990 et 20231. Selon le GIEC, cette tendance devrait se poursuivre, avec une augmentation attendue entre 1,3°C et 5,3°C d’ici 2100.2
Dans ses plans d’adaptation, le gouvernement anticipe un climat à + 4°C en 2100 et lance un nouveau plan national pour agir face aux changements climatiques ! De quoi faire réfléchir…
Les données climatiques montrent une accélération préoccupante des phénomènes extrêmes qui affectent directement le cadre bâti.
Les épisodes de précipitations intenses multiplient les inondations aux conséquences dévastatrices (destruction d’infrastructures, dissémination de polluants et mise en danger des populations). Celles survenues dans les Hauts-de-France, entre novembre 2023 et janvier 2024, ont généré 640 millions d’euros de dommages.3
Des périodes de sécheresse prolongée induisent une baisse des ressources en eau, accroissent les mouvements de sol et créent des conditions propices aux incendies (avec une augmentation de 20 % des zones à risques en Europe depuis 1971). Celle de 2022, par exemple, a aussi généré environ 3,5 milliards d’euros de dommages. 3
De fortes vagues de chaleur créent un inconfort thermique croissant pour les populations.
Des phénomènes de vents violents, de tempêtes, d’orages et de grêles s’intensifient et mettent en péril les constructions.
Pratiques de construction : les défis à relever
Du choix des matériaux aux modes de conception, les méthodes de construction conventionnelles doivent aujourd’hui intégrer la notion de résilience : évaluer et prendre en considération les risques présents et futurs liés aux impacts climatiques.
Une vulnérabilité accrue en milieu urbain
En ville, les effets du changement climatique et les risques liés sont amplifiés par des facteurs structurels entraînant des phénomènes tels que les îlots de chaleur urbains. Ce dernier peut entraîner des écarts de température nocturne de jusqu’à 10°C entre l’agglomération parisienne et les zones alentour.4
Ces conditions climatiques entraînent une forte consommation d’énergie liée à la climatisation, émettant de la chaleur hors des bâtiments. Leurs conséquences peuvent aussi être dramatiques. En 2003, la canicule a entraîné une surmortalité de 141 % à Paris contre 40 % en zone rurale 2 – soulignant l’urgence d’adapter l’aménagement urbain aux enjeux climatiques.
Une urbanisation imperméable
L’utilisation massive de surfaces imperméables en milieu urbain empêche l’infiltration naturelle de l’eau, ce qui engendre :
un ruissellement excessif qui sature les réseaux d’évacuation et augmente les risques d’inondation (en ville, 55 % des précipitations ruissellent, contre seulement 10 % en zone rurale)4 ;
la réduction de l’évapotranspiration, qui limite le rafraîchissement naturel de l’air.
Avec plus de 500 km² urbanisés chaque année en Europe5, ce déséquilibre continue de s’aggraver.
Structures et espaces : d’autres facteurs aggravants
D’autres aspects des modes actuels de conception des espaces accroissent cette augmentation de la température en ville :
- une isolation thermique insuffisante des bâtiments, entraînant une surconsommation énergétique, tant pour le chauffage que pour la climatisation ;
- un manque d’espaces végétalisés et de zones d’ombre, privant les villes de régulateurs thermiques naturels ;
- une densité urbaine élevée limitant la circulation de l’air et empêchant la dissipation de la chaleur.
Les solutions pour un bâti plus résilient
Les solutions « vertes » : intégrer le végétal et l’eau dans l’architecture
Le végétal et l’eau, intégrés dans l’architecture urbaine, favorisent l’évapotranspiration et le rafraîchissement de l’air.
Dans les faits, cela se traduit par la mise en place d’une vraie politique de végétalisation et de recréation d’un cycle d’eau dans les métropoles. Celle-ci passe, par exemple, par l’aménagement de parcs urbains, l’installation de toitures et façades végétalisées, ou encore la création d’espaces verts inondables (zones humides). Pour un déploiement réussi, ces solutions doivent être pensées dès la phase de conception des projets. L’objectif : anticiper un certain nombre d’aspects techniques (gestion des systèmes d'irrigation, entretien de la végétation, renforcement des façades à végétaliser…).
Les solutions « grises » : repenser la planification urbaine et les matériaux
L’albédo, ou réflectivité solaire, mesure la capacité d'une surface à réfléchir la lumière solaire, quantifiant la chaleur qu’elle renvoie. Les surfaces minérales sombres, caractérisées par un faible albédo, absorbent et stockent la chaleur au lieu de la réfléchir. Elles contribuent ainsi au phénomène d’îlot de chaleur urbain, et à l’augmentation locale des températures.
Diverses techniques peuvent être déployées pour limiter la surchauffe, faciliter la circulation de l’air ou la gestion des eaux… C’est le cas de l’installation d’éléments d’ombrage (auvents, pergolas, etc.) pour limiter la surface de voirie exposée au soleil, ou de la mise en place de chaussées à structure réservoir (CSR). Ces dernières jouent un rôle central dans la gestion des eaux pluviales en recueillant, stockant et restituant les eaux tombant sur les voiries et toitures.
Pour augmenter la résilience des bâtis et leur confort, différents matériaux peuvent être utilisés :
- les matériaux clairs, avec un fort albédo pour réfléchir la chaleur ;
- les matériaux poreux et drainants (comme les bétons drainants ou les sols stabilisés) pour faciliter l’infiltration, le stockage de l’eau et l’évapotranspiration ;
- les matériaux bas carbone pour réduire l’empreinte environnementale des constructions (matériaux biosourcés, bétons bas carbone…).
Le béton, un allié face aux enjeux climatiques
En matière d’aménagement résilient, il n’y a pas de solution miracle. Selon l’environnement à transformer et l’application ciblée, faire entrer en synergie plusieurs dispositifs est le seul moyen d’améliorer la résilience des constructions face au changement climatique.
Et en fonction du projet, le béton fait partie des solutions mobilisables.
L’effet albédo du béton face aux îlots de chaleur urbains
Avec un albédo maîtrisé compris entre 0,4 et 0,8, le béton réfléchit davantage la lumière que les enrobés bitumineux traditionnels (0,05 à 0,15).5
Il faut donc tirer profit de la variété de couleurs disponibles parmi les bétons sur le marché. Certains produits réduisent significativement l’échauffement des surfaces urbaines.
Une meilleure gestion de l’eau grâce au béton drainant et poreux
L’innovation autour du béton a généré une vaste gamme de matériaux, dont les bétons drainants et poreux. Ces derniers, de plus en plus considérés pour les projets d’aménagement (cours d’école, trottoirs, parkings, etc.), constituent une excellente réponse à l’enjeu de perméabilisation des sols urbains. Leur structure ouverte favorise l’infiltration naturelle des eaux pluviales vers le sol sous-jacent – une conception qui offre de nombreux bénéfices :
- réduction du ruissellement et du risque d’inondation ;
- contribution au rechargement des nappes phréatiques ;
- réduction des coûts de traitement de l’eau ;
- limitation de l’érosion.
Vicat propose, par exemple, plusieurs solutions de bétons drainants au sein de sa gamme Aquapass.
Le béton bas carbone pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
Grâce au phénomène de carbonatation, le béton absorbe entre 25 et 50 kg de CO2 par tonne sur son cycle de vie. Cependant, en contrepartie, sa fabrication reste source d’importantes émissions de CO2.5
Pour y remédier, des solutions émergent, comme le béton bas carbone, qui utilise des ciments à teneur réduite en clinker, principal responsable des émissions de GES du matériau.
Au-delà du béton bas carbone, des solutions comme le béton de chanvre possèdent d’excellentes propriétés isolantes réduisant les besoins en chauffage et en climatisation, et donc les émissions de gaz à effet de serre.
L’intensification des risques climatiques impose une évolution des pratiques de construction dans le secteur du bâtiment. L’intégration de solutions végétales, de matériaux innovants et de nouvelles stratégies d’urbanisme doit être pensée dès la conception des projets.
Pour agir face aux aléas climatiques, Vicat s’engage dans le projet national ISSU (Innovations et Solutions pour lutter contre la Surchauffe Urbaine) et développe des solutions innovantes comme les bétons bas carbone et les bétons drainants.



La newsletter Linkedin consacrée aux solutions de la construction durable
Explorons chaque mois les enjeux, les besoins et les solutions liés à la construction décarbonnée en France.
Laurent LEGAY - Directeur marchés et offre - Vicat